
L’Espagne fut, dans les années 1950 à 1980, l’un des rares pays d’Europe occidentale à entretenir l’ambition de se doter d’une arme nucléaire nationale. Derrière cette volonté figurait la double obsession du régime franquiste : garantir la survie stratégique du pays hors des alliances officielles de la Guerre froide et affirmer sa prétention à rejoindre le cercle des grandes puissances technologiques. Pourtant, cette aventure connue sous le nom officieux de Proyecto Islero se solda par une succession d’échecs techniques, diplomatiques et politiques qui illustrent à quel point la science atomique buta, en Espagne, sur un appareil d’État fragile, un isolement international persistant et une incapacité chronique à concilier ambition militaire et moyens civils.
Les origines franquistes : un rêve fou de redevenir une grande puissance
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le régime de Franco, isolé et ostracisé par les démocraties occidentales, se voit privé d’accès aux réseaux scientifiques et industriels européens. Néanmoins, dès 1948, les médecins José María Otero Navascués et Manuel Lora-Tamayo ont obtenu du Caudillo son aval pour créer la Junta de Energía Nuclear (JEN), ancêtre du futur Centre d’Investigation Énergétique, Environnementale et Technologique (CIEMAT). Cette structure, spécifiquement dédiée à l’étude de l’énergie atomique civile, visait dès ses débuts le double usage — scientifique et militaire — du nucléaire.

À Madrid, les ambitions atomiques s’inscrivent dans un imaginaire nationaliste : l’Espagne, jadis empire universel, devait prouver qu’elle demeurait capable des plus hautes conquêtes techniques. Les premières recherches sur la fission de l’uranium et la production de plutonium furent réalisées avec des moyens dérisoires : minéraux extraits des gisements d’Andalousie, récupération de matériel américain obsolète et formation de scientifiques souvent autodidactes. Faute d’accords internationaux, l’Espagne dépendait du troc technologique et de coopérants étrangers discrets, notamment français, argentins et israéliens.
Le « Proyecto Islero » : de l’illusion à la désillusion
C’est au début des années 1960 qu’émerge réellement le Proyecto Islero , ainsi nommé d’après le taureau qui tua le torero Manolete, symbole d’une force meurtrière et incontrôlée. L’objectif : créer une bombe nucléaire espagnole en partant d’un réacteur national capable de produire du plutonium de qualité militaire. L’appui tacite des milieux militaires, notamment du ministère de l’Armée, permet d’ouvrir des laboratoires secrets à Madrid et Ciudad Universitaria, tandis que des études métallurgiques étaient conduites à JEN sous haut secret.
Mais la stratégie d’Islero se heurta rapidement à des réalités insurmontables. En 1955, sous pression américaine, l’Espagne avait signé les premiers accords bilatéraux « L’atome pour la paix », censés encadrer strictement l’usage civil du nucléaire. Toute tentative de dérive militaire serait interceptée par Washington, qui craignait de voir Madrid briser le fragile équilibre méditerranéen. Les États-Unis offrent en échange une aide technique contrôlée — des réacteurs de recherche à faible rendement et du combustible faiblement enrichi — verrouillant de fait tout espoir d’autonomie militaire.
Les déboires technologiques
Sur le plan scientifique, les ingénieurs espagnols accumulèrent les revers. Le réacteur d’uranium naturel et d’eau lourde que la JEN tente de concevoir ne dépassa jamais le stade expérimental. Les difficultés portaient sur la pureté chimique du combustible, l’étanchéité des circuits et la maîtrise de la radioprotection. Les installations d’Andújar et de Soria, pensées pour l’extraction et la concentration d’uranium, s’avérèrent sous-performantes et dangereuses pour les travailleurs. Quant aux calculs nécessaires à l’explosion contrôlée d’un moteur nucléaire, ils excédaient de loin les capacités informatiques de l’époque en Espagne.
Les rares succès du programme furent indirects : en 1968, la mise en service de la centrale de Zorita (José Cabrera), première centrale nucléaire espagnole raccordée au réseau, permis d’ancienne une génération d’ingénieurs atomistes. Mais la finalité restait civile et encadrée par les partenaires occidentaux. Franco lui-même, vieillissant et obsédé par sa succession, n’eut ni la volonté ni les moyens d’affronter une interdiction frontale américaine.

L’abandon sous la Transition
À la mort du Caudillo en 1975, ses derniers partisans militaires rêvaient encore d’un «noyau dissuasif ibérique» capable de rivaliser avec la France gaulliste. Une note confidentielle de la JEN de 1976 évoque la possibilité de fabriquer une bombe « de type Nagasaki » dans un délai de cinq ans, à condition d’obtenir une fourniture clandestine de plutonium. Mais le contexte politique avait radicalement changé : le gouvernement d’Adolfo Suárez engageait la transition démocratique et cherchait la reconnaissance internationale. La révélation d’un programme militaire secret aurait ruiné les négociations d’adhésion à la Communauté économique européenne et à l’Agence internationale de l’énergie atomique.
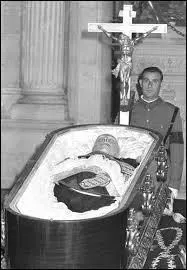
Sous pression de Washington et de Bonn, Madrid a signé en 1987 le Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP), entérinant la fin définitive du rêve atomique militaire espagnol. Le Proyecto Islero fut enterré administrativement, ses archives classées « Confidencial » au sein du CIEMAT. Plusieurs ingénieurs furent réorientés vers le développement civil des centrales nucléaires espagnoles, qui connurent, de Vandellós à Almaraz, un essor considérable mais contesté.
Un héritage ambivalent
Le programme atomique espagnol laisse derrière lui un mélange de fierté et de désillusion. Il permet à l’Espagne d’acquérir une compétence technique réelle dans le domaine de la physique nucléaire, mais révèlea aussi la profondeur de son retard industriel et de sa dépendance vis-à-vis des puissances occidentales. Culturellement, Islero symbolise une tentative avortée de grandeur : celle d’un pays qui voulait rivaliser avec les puissances atomiques mais dut se résigner à l’impossible, faute de ressources, de stratégie cohérente et de continuité politique.
De cet épisode, il reste l’ombre d’une ambition trop grande pour les dimensions d’un État alors en pleine recomposition, et la démonstration qu’en matière nucléaire, la souveraineté scientifique ne s’improvise pas — surtout quand la diplomatie, la technique et la politique travaillent chacune à contre-courant des autres.


