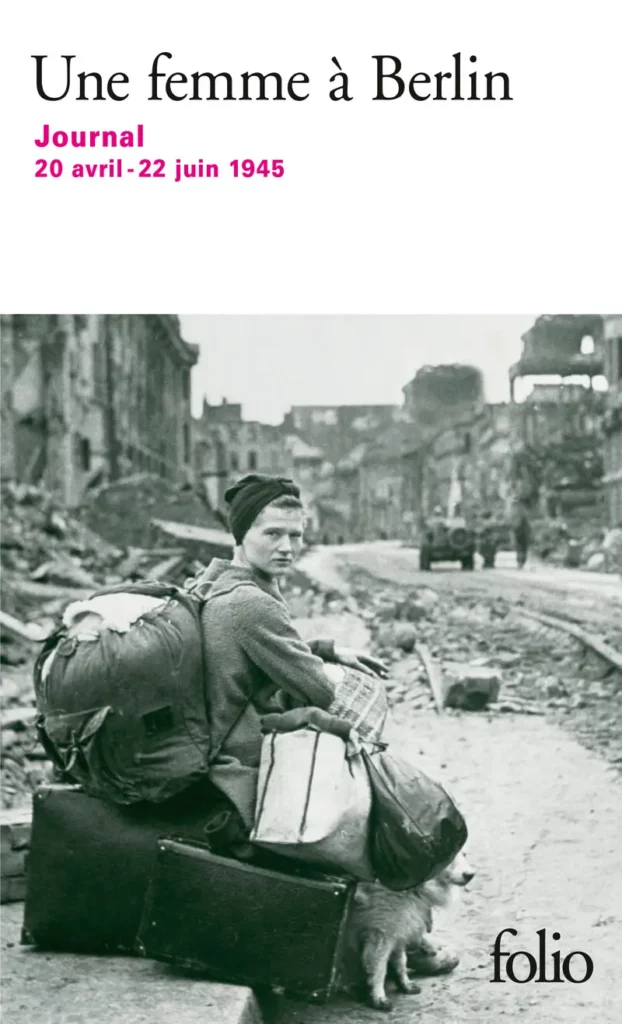
Deux Procureurs, Sergei Loznitsa, 2025 (1h46)

1937, Union Soviétique, des milliers de lettres de détenus accusés à tort par le régime sont brûlées dans une cellule de prison. L’une d’elle contre toute attente arrive à destination sur le bureau du procureur local fraîchement nommé, Alexander Kornev. Il décide de rencontrer le prisonnier, victime du NKDV, la police secrète. Bolchévique convaincu et intègre, le jeune procureur croit à un dysfonctionnement. Sa quête de vérité le mènera jusqu’au bureau du procureur général de Moscou. En pleines purges staliniennes, c’est le destin d’un jeune homme idéaliste qui se fait broyer par la machine totalitaire.
Le film s’ouvre sur la prison d’une localité de province où Alexander demande une audience au directeur pour rencontrer le détenu politique dont le mot, faute de crayon, avait été écrit sur un carton avec un clou et son propre sang. Arrivé à 8h30 du matin, après que le directeur l’ait découragé en lui disant que le prisonnier était dans l’aile ultra sécurisée et interdite de la prison, soi-disant malade, contagieux, dangereux et l’avoir fait attendre la journée entière, il finit par rencontrer le vieux Bolchévique.
Une longue séquence dans le dédale des couloirs à la longueur interminable sur plusieurs étages avec de nombreux check points gardés par des hommes armés, des grilles de fer au-dessus des escaliers pour ne pas que les détenus sautent dans le vide, se déroule sous le regard du spectateur pris par un sentiment d’oppression très kafkaïen. Le procureur accède enfin à la cellule du prisonnier qui lui montre ses nombreuses blessures dues aux tortures qu’on lui a infligées. Très affaibli, il n’attend pas grand-chose de sa rencontre avec lui si ce n’est que la vérité éclate. Des innocents, de loyaux anciens révolutionnaires fidèles au régime sont emprisonnés, torturés, tués quel que soit leur rang ou leur statut.
Alexander part sans prévenir sa hiérarchie pour Moscou afin d’avoir une audience auprès du procureur général qu’il veut informer. Celui-ci l’écoute poliment. En bon bureaucrate stalinien, il lui demande un compte-rendu écrit des faits. Apparemment bien disposé, il lui envoie un chauffeur pour l’emmener à la gare et lui paye le billet de train de retour. La suite pour le jeune procureur semble inévitable, pressentie dès le début du film, quand la dernière séquence se referme sur la porte de la prison qu’il avait visitée où l’emmènent deux soi-disant ingénieurs, des agents du NKDV, rencontrés dans le train. Le réalisateur laisse imaginer au spectateur la fin tragique du procureur avec un faux procès expéditif, une condamnation à mort pour trahison, dans le meilleur des cas la déportation au goulag à vie.
Joseph Staline règne à cette époque en maître absolu sur la fédération de l’Union soviétique depuis le décès de Lénine 21 janvier 1924. Même sa garde rapprochée, ses lieutenants à son service dont d’anciens camarades de la Révolution, tombent les uns après les autres dans un climat de terreur effroyable. Peu en réchappent dont certains meurent sous la torture de crise cardiaque.
À sa mort en mars 1953, un espoir de démocratie traverse le pays quand Nikita Khrouchtchev prend le pouvoir, vite déçu. Il faudra attendre presque quarante ans avant que le régime ne s’effondre, un des plus criminels au monde. Vingt-quatre millions de Soviétiques ont été déportés dans les goulags en Sibérie dont la plupart n’est jamais revenue. Des famines orchestrées par Staline ont fait des millions de morts en Ukraine et dans le Caucase. Les paysans ont été dépossédés de leurs terres au nom du collectivisme. Exilés dans les villes pour faire tourner les usines, la propriété privée interdite, ils vivaient dans des habitats collectifs où la délation était la règle. Des agents du KGB (anciennement NKDV) infiltrés surveillaient les colocataires, les épiant, écoutant leurs conversations, observant tous leurs faits et gestes, ce qu’ils mangeaient, quels journaux ils lisaient, quelle musique, quelle radio ils écoutaient, qui ils recevaient chez eux, avec qui ils passaient la nuit… Il était interdit de se déplacer d’une région à l’autre sans autorisation administrative, sans passeport intérieur. N’importe qui pouvait être mis sur écoutes téléphoniques, filé, dénoncé, arrêté, de faux aveux extorqués sous la torture, interné en hôpital psychiatrique, déporté au goulag ou tué. C’était le cas également en Allemagne de l’Est avec la Stasi qui terrorisait les populations.
Le compositeur Dimitri Chostakovitch (1906-1975) raconte dans un recueil de ses mémoires1 publié en 1980 – Staline le détestait, il ne comprenait rien à sa musique – qu’il vivait dans la crainte perpétuelle d’être arrêté, comme l’avait été nombre de ses amis compositeurs et artistes qui n’avaient pas eu la chance d’être connus mondialement comme lui. Il avait toujours une valise près de la porte d’entrée prête à emporter quand la police politique viendrait le chercher au petit matin, situation qui a duré jusqu’à la fin de ses jours. Il n’avait eu la vie sauve que grâce à sa renommée internationale contre laquelle le chef du Kremlin et les apparatchiks du parti n’avaient rien pu faire.
La Disparition de Joseph Mengele, Kirill Serebrennikov, 2025 (2h16)
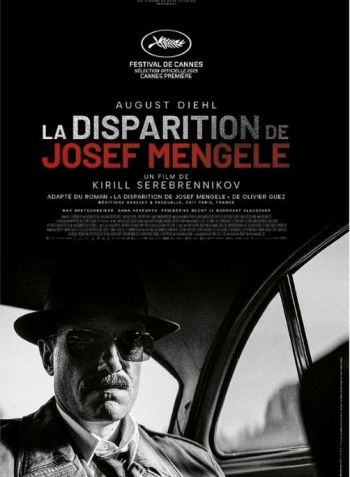
1977, Rolf, trente-trois ans, le fils de Joseph Mengele, débarque au Brésil à la recherche de son père. Il finit par le retrouver dans un village où âgé, il vit seul, en mauvaise santé. Un dialogue de sourds s’instaure entre le père et le fils. Rolf ne cesse de lui demander pourquoi il est allé à Auschwitz, s’il a torturé des gens, quelles expérimentations il a menées sur les déportés ? Le médecin nazi lui répond invariablement qu’il n’a fait que son devoir, fidèle au Führer, qu’il a travaillé au service de la nation allemande, pour la science, que les détenus de toute façon seraient morts tôt ou tard… Aucun remord, aucune culpabilité ne l’effleure.
Le film aux trois quarts en noir et blanc fait plusieurs retours en arrière sur la fuite de Mengele en Amérique latine, après qu’il ait quitté l’Europe en 1949 pour Buenos Aires. En 1956, il obtient un permis de séjour argentin et sous son vrai nom part en Allemagne dans sa famille en Bavière où son père Karl, ancien nazi, conseiller municipal de Günzburg, a une manufacture de machines agricoles. Il lui propose de travailler avec lui et son frère en lui expliquant que la dénazification a eu lieu, qu’il n’y a plus rien à craindre du passé. Toute la ville vit grâce à eux. Méfiant, sans doute l’esprit pas très tranquille, il refuse et repart en Argentine. Il ne reviendra plus jamais en Europe.
Martha sa belle-sœur, veuve avec un enfant, part avec lui où ils se marieront en Uruguay en 1958 qui sera l’occasion d’une grande fête avec ses amis nazis fugitifs comme lui. Les premières années de sa cavale se passent sans encombres mis à part quand il est interrogé en 1958 par la police pour avoir avoir exercé illégalement la médecine et pratiqué des avortements clandestins à Buenos Aires. Il s’en sort en versant un pot-de-vin au policier. En 1960, l’étau se resserre quand Adolf Eichmann est enlevé par le Mossad pour être jugé à Jérusalem. Il s’installe d’abord au Paraguay, puis dans une ferme au Brésil chez un couple d’expatriés hongrois avec leurs deux enfants. Sa femme, lasse de déménager en permanence, l’avait quitté peu avant et était retournée en Allemagne.
Des tensions règnent entre lui et le couple de fermiers bien qu’il ait une liaison avec la femme. Ils découvrent dans la presse sa vraie identité, qu’il est recherché pour crimes contre l’humanité. Des membres de la famille de Mengele viennent régulièrement à la ferme leur verser de l’argent pour qu’ils ne le dénoncent pas. La fin du film le montre âgé et malade après avoir fait un AVC, dans un bungalow où une jeune femme s’occupe de lui dans la journée. Il meurt noyé sur une plage près de São Paulo suite à une seconde attaque cérébrale et est enterré sous sa fausse identité.
Un texte final indique que Rolf reconnaîtra le corps en 1985 après son identification (confirmée par des analyses génétiques en 1992) mais refusera avec sa mère que ses restes soient rapatriés en Allemagne. Le corps sera légué à l’institut médico-légal de São Paulo qui est la première séquence du film où un professeur d’anatomie devant le squelette de Joseph Mengele, décrit à ses étudiants les caractéristiques qui ont permis de l’identifier. Plusieurs rares scènes du film en couleur, le montrent jeune, à l’époque de sa rencontre avec sa première femme, puis à Auschwitz quand médecin nazi, il sélectionnait sur la rampe les arrivants au camp, les femmes avec enfants, celles enceintes, les vieillards pour la chambre à gaz et ceux qui auraient un sursis, aptes au travail ; une famille de nains qu’il gardait de côté pour ses expériences ; des enfants à qui il offrait des bonbons avant de les tuer. Sa vie passée « lumineuse » en couleur, est mise par le réalisateur en contraste avec sa vie « sombre » de cavale, en noir et blanc.
Il avait échappé plusieurs fois de peu au Mossad qui en 1962, a renoncé à le pourchasser. Cela demandait trop de moyens en temps, en hommes et en argent et les Israéliens le pensaient mort comme l’avaient déclaré sa première femme et sa famille.
En février 1945 à Saaz (Tchéquie), déguisé en officier de la Wehrmacht, il fuit vers l’Ouest où il est fait prisonnier par les forces américaines en juin. N’ayant pas le tatouage des SS avec son groupe sanguin, il n’est pas identifié comme criminel de guerre et est libéré en juillet. Avec de faux papiers « Fritz Ullman » changé en « Fritz Hollman », il travaille comme ouvrier agricole près de Rosenheim en Bavière. Après avoir obtenu à Gênes un passeport sous la fausse identité de « Helmut Gregor » par la Croix-Rouge, il part en Argentine en juillet 1949. Sa femme, la mère de Rolf, Irène Schönbein qu’il avait épousée en 1939, refuse de le suivre. Ils divorceront en 1954. Les premières années de sa cavale se déroulent comme charpentier, commercial dans l’entreprise familiale de machines agricoles avec jusqu’en 1951, de fréquents déplacements au Paraguay pour le travail.
Né à Günzburg en Bavière le 16 mars 1911, il avait obtenu deux doctorats en anthropologie (1935) et en médecine (1938) à l’université de Munich. Il adhère au parti nazi en 1937, à la SS (Schutzstaffel) en 1938. Après avoir été mobilisé en juin 1940 comme volontaire dans le service médical de la Waffen-SS, puis au sein du Rasse und Siedlungshauptamt (RuSHA), le Bureau pour la race et le peuplement, à Posen en Pologne avec pour mission d’évaluer les candidats à la germanisation, il intègre en janvier 1942 la 5e Panzerdivision SS Wiking comme médecin. Grièvement blessé près de Rostov-sur-le-Don (Russie) à l’été 1942, il est déclaré inapte au service actif et rejoint le bureau de Berlin du RuSHA où il travaille à nouveau avec Otmar von Verschuer, médecin eugéniste. Promu Hauptsturmführer SS (capitaine), il est envoyé au camp d’Auschwitz-Birkenau en avril 1943 dont le responsable médical Eduard Wirths le nomme chef du Zigeunerfamilienlager, le camp des Roms, où il aura à sa disposition un vivier humain pour ses expériences médicales.
Ses recherches portaient sur les jumeaux, l’hétérochromie (couleur différente des deux yeux), le nanisme et les difformités anatomiques, à des fins génétiques et eugéniques. Il a « éradiqué » des épidémies de typhus et de scarlatine en isolant et laissant mourir les malades sans soins, a reçu des médailles pour cela, provoqué des maladies par infection volontaire, pratiqué des amputations inutiles, injecté des substances hormonales dans les yeux de détenus qui ont entraîné leur cécité. À la mi 1944, il avait envoyé une quarantaine de paires d’yeux disséqués à l’Institut Kaiser-Wilhelm d’anthropologie à une collègue biologiste. La liste d’atrocités est longue… Il avait créé dans le camp un terrain de jeux pour les enfants qui l’appelaient « Onkel Mengele » avec qui il jouait avant de les tuer par injection létale ou lors d’expérimentations.
Totalitarisme ou dictature ?
Quel intérêt de s’attarder sur un médecin coupable de crimes contre l’humanité ? Les Mengele et les Eichmann également ne manquaient pas à l’époque… La profession de médecin était une des plus nazifiées, plus de 50 % étaient membres de la SA (Sturmabteilung) et la SS. Vingt seulement seront jugés au procès de Nuremberg des médecins et des fonctionnaires nazis (9 décembre 1946-29 août 1947), condamnés pour « barbaries faites au nom de la science médicale », dont sept à la peine de mort par pendaison. Certains avaient participé au programme Aktion T4 d’extermination par le gaz des handicapés mentaux et physiques dans les années trente en Allemagne, à laquelle l’église protestante avait mis un terme en le dénonçant. Les euthanasies ont pourtant continué de façon non officielle par des médecins et infirmiers dans des hôpitaux et cliniques du pays et des territoires occupés jusqu’en 1945, par injection létale à des enfants malformés ou ne correspondant pas aux critères ariens, des personnes âgées et des blessés de guerre (nombreux suite à la campagne de Russie). Beaucoup de ces médecins ont disparu à la fin de la guerre et n’ont jamais été jugés comme Mengele (Flores, 2022).
Les juristes diplômés des meilleures universités n’étaient pas en reste non plus, nombreux au parti nazi. L’arrivée d’Hitler au pouvoir a été une opportunité pour quantité de petits fonctionnaires qui auraient végété comme Eichmann, sans la fabuleuse promotion qu’il leur était offerte, aussi pour des Allemands, détenus de droit commun, des criminels qu’on a sortis de prison pour être enrôlés dans les organisations nazies comme Rudolf Höss, le chef du camp d’Auschwitz-Birkenau.
La défense d’Eichmann à son procès a été qu’il ne faisait qu’obéir aux ordres. Cela n’a pas convaincu les juges. Il ne se contentait pas non plus uniquement de « faire partir les trains à l’heure »… comme j’ai pu l’entendre ici ou là. Il savait très bien ce que les convois de wagons plombés transportaient et où ils allaient. Des photos d’archives ont été retrouvées après la guerre où on le voit en visite au camp d’Auschwitz. En Autriche à Vienne en 1938, il était chargé d’organiser l’expulsion des Juifs en confisquant leurs biens. Il était l’adjoint de Reinhard Heydrich, ancien directeur de l’Office central de sécurité du Reich, vice-gouverneur de Bohême-Moravie, tué à Prague par des résistants en juin 1942. Il avait participé avec lui à la conférence de Wannsee le 20 janvier 1942 sur la solution finale où il était le secrétaire de séance chargé de rédiger le compte-rendu.
Une dictature raciale
Un contresens est souvent fait sur « la banalité du mal » de la philosophe Hannah Arendt. Eichmann et tant d’autres criminels n’ont en aucun cas commis des actes banals mais ils étaient des êtres ordinaires, sans envergure, des Allemands communs, que le régime a transformé en meurtriers.
Les travaux des historiens de la Seconde Guerre mondiale ces dernières décennies, ont montré que le régime nazi était un régime racial, une dictature mais pas un totalitarisme comme l’Union soviétique. La nature du Troisième Reich est une dictature violente pour ses opposants et une « dictature au service du peuple et de son bien-être » pour toutes les personnes non ciblées par le régime, fondée sur la Volksgemeinschaft (communauté du peuple, forme idéale de société), la participation et le consentement massif de la population.
Certes, la dictature s’exerçait durement avec son lot de déportés, d’assassinés, mais pas pour tout le monde. Pour l’Allemand dit de souche de l’époque qui travaillait, élevait ses enfants et ne faisait pas de politique, en clair se tenait tranquille, la vie se déroulait plutôt bien. Pour les Juifs (seulement 0,8 % de la population en 1933), les Tziganes, les Slaves, les opposants politiques, les homosexuels, les « asociaux », il en allait tout autrement évidemment puisqu’il faisaient l’objet de persécutions continuelles, d’emprisonnement dans les camps de la mort, d’exécutions. Pour les autres, les Allemands ariens, il n’y avait pas de danger, il suffisait quand une rafle de Juifs avait lieu dans la rue, de regarder ailleurs…
Les nazis s’arrangèrent pour que le peuple allemand ne manque de rien, ni de travail (les usines d’armement entre autres tournaient à plein régime), ni de denrées alimentaires et de biens de consommation de nécessité, qu’ils pillaient dans les territoires occupés comme la France, au moins jusqu’en 1943 quand les alliés ont commencé à bombarder jour et nuit les villes et villages, pas seulement les zones stratégiques industrielles comme la Ruhr ou le port de Hambourg, afin de démoraliser la population. Le souvenir cauchemardesque de la République de Weimar des dernières années à la démocratie agonisante quand l’inflation flambait et la misère avec, était toujours dans les esprits. Les Allemands ont voté massivement pour Hitler lors des élections de 1933 avec 17,2 millions de suffrages (43,9 % des voix). Ils appelaient à un homme fort, charismatique, dévoué à la nation, célibataire qui se déclarait « marié » à l’Allemagne… qui prônait la paix tout en réarmant le pays.
Les organisations de jeunesse la Hitler Jugend et la Bund Deutscher Mädel qui prenaient en charge les garçons et les filles dès l’âge de six ans en leur proposant des activités de plein air, des feux de camp entre camarades, des marches, du sport, des manifestations au flambeau, étaient très appréciées et contribuaient à une sorte d’union sacrée entre les jeunes Allemands, les garçons en se préparant à être de vaillants soldats, les filles à leur rôle dévolu de ménagères, mères de famille nombreuse. D’après J. Chapoutot, C. Ingrao, N. Patin (2024)2 : « L’adhésion au nazisme a bien montré que le régime ne tenait pas que par la terreur, loin de là. Ian Kershaw le dit : ‘’Bien entendu, la répression était partie intégrante du régime nazi depuis le début. (…) Mais, si omniprésente fût-elle, la répression avant-guerre se concentrait sur les groupes ‘marginaux’ et les ‘indésirables’, la majorité de la population l’acceptait, voire s’en félicitait’’. (…) un phénomène que l’on analyse aujourd’hui comme une gigantesque ‘’fabrique du consentement’’ ». La bourgeoisie terrorisée par le « judéo-bolchévisme » a préféré s’en remettre à un petit caporal antisémite…
Les lois de Nuremberg de 1935 dans son article 3, la « Loi sur la protection du sang allemand et de l’honneur allemand » allait jusqu’à prohiber l’emploi comme domestiques par les Juifs de femmes allemandes en dessous de 45 ans. Les Juifs étaient considérés comme des déviants sexuels qui menaçaient la pureté du « sang allemand »… Aussi, c’était un régime racial que les anthropologues partis en missions, dès le XIXe siècle, avaient validé en mesurant les crânes des peuples indigènes. Ces crânologues… eugénistes donnèrent un vernis scientifique à la notion de « race » (qui n’existe pas), la race arienne fantasmée étant supérieure aux autres.
Aussi, le nazisme était bien une dictature avec toutes les restrictions de libertés qu’on connaît, de la presse, d’opinion, avec un parti unique, sans élections libres, une bureaucratie parasitaire, une répression politique, un homme fort au pouvoir, la propagande d’état rondement menée par le ministre Joseph Goebbels, etc. Mais, elle se distingue du totalitarisme, soviétique notamment, pas seulement en termes de nombre de personnes exécutées et déportées ni de restrictions des libertés fondamentales mais par la fabrication du consentement et l’adhésion massive du peuple allemand à l’extrême-droite, à l’antisémitisme, aux mesures anti-démocratiques. En 1945, 8 millions 981 000 Allemands étaient adhérents au NSDAP, même si tous n’étaient pas nazis. Certains étaient membres du parti par opportunisme, conformisme social, pour trouver un travail ou simplement le garder…
Un totalitarisme sans nom…
Les Soviétiques quels qu’ils soient dans l’immense fédération de républiques qu’était l’URSS, où des peuples aux mœurs et aux langues différentes se côtoyaient, subissaient une répression féroce qui s’abattait arbitrairement en pouvant jeter à la rue n’importe qui, un simple paysan comme un haut dignitaire proche de Staline. L’Armée rouge qui a contribué à la victoire des alliés, a payé un lourd tribut en hommes. Pourtant, les prisonniers de guerre qui avaient survécu aux camps nazis, une fois rentrés en 1945, étaient exécutés sur ordre de Staline. Faits prisonniers, ils étaient forcément des déserteurs… qui s’étaient rendus à l’ennemi au lieu de combattre jusqu’au bout.
Appartenir à la nomenklatura, accordait des privilèges immenses aux responsables et aux bureaucrates corrompus qui administraient le pays, tandis que le reste de la population souffrait régulièrement de faim et de froid. Tous les biens de consommation importés de l’Ouest leur étaient accessibles, les mieux placés avaient leur datcha au bord de la mer de Crimée… Mais même les plus puissants, les collaborateurs de Staline, tombés en disgrâce du jour au lendemain, étaient fusillés, leur portrait effacé sur les photos retouchées où ils avaient posé avec le maître du Kremlin. Être pris dans les filets du KGB ou de la Stasi, signifiait perdre son emploi, ne plus jamais en retrouver et être considéré comme un « parasite social » car le chômage évidemment n’existait pas dans les pays communistes… Le système de délation qui recrutait ses espions dans la population en les payant ou en les menaçant des pires représailles s’ils refusaient, était particulièrement efficace. Ainsi, un fils, une fille, pouvait dénoncer ses parents ou inversement. C’était une société particulièrement injuste et inégalitaire malgré les beaux discours révolutionnaires (Marie, 2013)3.
Les témoignages des Allemands quand l’Armée rouge est entrée à Berlin sont particulièrement éloquents. Certes, les Russes n’avaient pas oublié les massacres perpétrés par les Einsatzgruppen, les formations SS, Les Chasseurs noirs (2006)4 comme les appelle Christian Ingrao qui, à l’arrière des troupes de la Wehrmacht « nettoyaient » les territoires envahis en exécutant tous les Juifs, les commissaires politiques mais aussi les paysans, hommes, femmes, enfants. Un esprit de revanche inévitable animaient les soldats quand ils envahirent la ville. Des viols massifs ont eu lieu, à tel point que les autorités ont dû établir et faciliter l’avortement, que l’histoire a préférés oublier pendant longtemps en y mettant une chape de plomb : il fallait reconstruire le pays.
Une femme à Berlin. Journal 20 avril-22 juin 1945 (1954)5, témoignage d’une Allemande anonyme, a raconté le calvaire vécu par les femmes violées collectivement dont elle-même. 100 000 d’entre elles dans le Berlin envahi l’ont été dont 10 000 mutilées et assassinées ou qui se sont suicidées par la suite. Elle avait choisi de se mettre sous la protection d’un officier de l’Armée rouge qui s’est installé chez elle et dans son lit évidemment… seul moyen aussi pour survivre quand toute la ville mourrait de faim. Il a fallu plus de dix ans à l’Allemagne pour se relever des décombres de la guerre, reconstruire le pays et relancer la machine économique.
Pour conclure…
Il ne s’agit pas d’établir une hiérarchie dans l’horreur en faisant le décompte des morts mais, de s’appuyer sur des faits historiques. Le mot totalitarisme est un peu trop galvaudé à mon goût. Cela lui enlève de sa force. Tout n’est pas totalitaire même si beaucoup peut être dictatorial… et faire l’amalgame entre les deux régimes, nazi et stalinien en considérant que c’est du pareil au même, est une erreur d’appréciation et d’analyse qui relève pour moi de l’imposture idéologique. Il est toujours tentant de réécrire l’histoire, de voir les choses comme on aimerait qu’elles soient et non pas telles qu’elles sont…
Les mesures sanitaires délétères qui nous ont été imposées pendant la crise du Covid-19, en fait politiques pour museler la population, relèvent de diktats, il n’y a aucun doute. Une démocratie est par essence fragile car elle laisse la porte ouverte aux débats, à l’opinion contradictoire, à la liberté de parole et de pensée et lorsqu’elle est attaquée par des idéologies mortifères ou des mesures répressives, autoritaires, elle est en danger. Aussi, la vigilance est de rigueur : se protéger de la propagande médiatique, réagir face à des décisions gouvernementales qui vont à l’encontre du peuple, mettre en garde contre les abus, les dénoncer, refuser les lois qui restreignent les libertés et les droits, la censure, etc. sont essentiels.
Le reste n’est qu’arguties de mon point de vue. Entretenir la peur du totalitarisme en permanence, en substituant une peur à une autre, n’apporte rien de positif, même si aucune démocratie n’est à l’abri de graves dérives liberticides comme celles auxquelles on assiste aujourd’hui dans les pays occidentaux. Et les appels à la guerre intempestifs actuels de l’Union Européenne ne font guère illusion…
© Bettina Flores, 21 novembre 2025.
1 : Solomon Volkov, propos recueillis par, Témoignage. Les mémoires de Dimitri Chostakovitch, Paris, Albin Michel, 1980.
2 : Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945, Paris, éd. Tallandier, 2024.
3 : Jean-Jacques Marie, Staline, Paris, éd. Autrement, 2013.
4 : Christina Ingrao, Les Chasseurs noirs. Essai sur la Sondereinheit Dirlewanger, Paris, éd. Tallandier, 2006.
5: Anonyme, Une femme à Berlin. Journal 20 avril-22 juin 1945, (1954), Paris, Gallimard, 2006. En 2003, son nom, Marta Hillers, a été révélé. Elle a été journaliste et rédactrice en chef de deux magazines à Berlin pendant la guerre.


