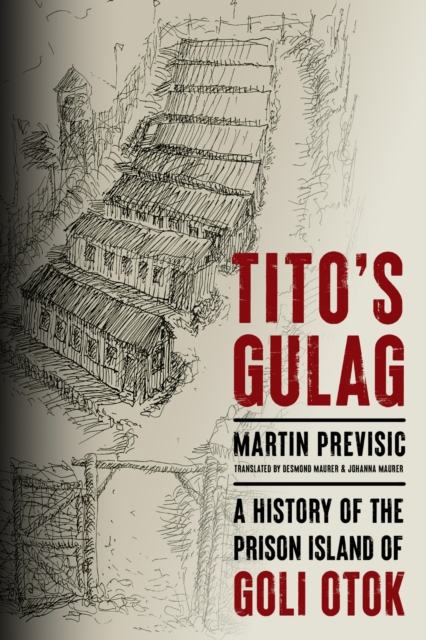
Le camp de Goli Otok, souvent surnommé « l’Alcatraz du Titisme », demeure l’un des chapitres les plus sombres et controversés de l’histoire de la Yougoslavie socialiste. Située sur une île désolée de l’Adriatique, au large de la côte croate, cette prison fut fondée à l’été 1949, au lendemain de la rupture entre Tito et Staline, afin d’accueillir les « ennemis intérieurs » du régime titiste. En s’appuyant sur le livre d’Alain Jejčič, mais aussi sur diverses études historiques, il est possible de retracer la genèse, le fonctionnement et la portée politique de ce centre de répression, tout en posant la question du silence occidental face à ces violences.

Origine et objectifs du camp
La naissance de Goli Otok s’inscrit dans la crise internationale qui frappe le mouvement communiste en 1948. L’affrontement entre Tito et Staline, matérialisé par la résolution du Kominform, ouvre pour le leader yougoslave la nécessité de purger le Parti et la société de tout soupçon de stalinisme et de trahison. L’île de Goli Otok, quasiment dépourvue de végétation, battue par les vents et la mer, signifie littéralement « île nue » : elle fut dès lors investie comme un lieu d’isolement total, à l’image de la marginalisation des suspects.
Selon Jejčič, les premières vagues d’internés étaient essentiellement constituées de membres du Parti communiste – cadres du KPJ, officiers, fonctionnaires, enseignants – suspectés d’hostilité à la ligne titiste, voire de tentatives de conspiration avec Moscou. Les autorités, guidées par l’UDBA (police politique), optèrent pour une politique de la terreur symbolique et matérielle, cherchant à extirper toute loyauté envers l’URSS.

Fonctionnement et vie quotidienne
Goli Otok n’était pas un camp d’extermination à la manière des camps nazis, mais il répartissait ses châtiments suivant une logique d’humiliation, de travail forcé et de rééducation politique brutale. La surveillance y était omniprésente, et la délation encouragée. Les détenus, selon la méthodologie décrite par Jejčič, étaient astreints à participer eux-mêmes à la gestion de la discipline — de sorte que le système reproduisait l’arbitraire policier jusque dans les rapports entre détenus.
Le programme du camp comprenait des travaux éreintants — extraction de pierres, construction de bâtiments sous un climat ingrat — et des séances d’autocritique inspirées par la culture politique soviétique, paradoxalement recyclée alors même qu’on prétendait combattre le « stalinisme ». Les punitions physiques, l’isolement, les privations alimentaires ou médicales et les brimades collectives étaient le lot quotidien. Beaucoup d’internés perdirent la raison, et plusieurs centaines moururent effectivement, mais le bilan réel est encore débattu.

Typologie des détenus et « réhabilitation »
Au fil des années, le profil des détenus a évolué. Initialement concentrée sur les communistes « suspects », la répression finit par englober des catégories plus larges : intellectuels, officiers, membres de minorités, petits entrepreneurs, voire des personnes exprimées sur la base de règlements de comptes locaux. L’enfermement n’était souvent précédé d’aucun procès équitable, et la durée des peines était indéterminée — la libération dépendant de la capacité supposée de l’individu à se « rééduquer ».
À partir de 1956, avec l’apaisement des relations entre Belgrade et Moscou, et le rapprochement consécutif avec l’Occident, de nombreux détenus furent relâchés et le régime du camp s’adoucit, avant que l’île ne soit progressivement vidée de ses prisonniers politiques au début des années 1960. Certains purent être « réhabilités » administrativement, mais la stigmatisation sociale, les séquelles psychiques et physiques, et le secret ayant entouré le camp, empêchèrent longtemps toute reconnaissance publique de la violence subie.
La mémoire refoulée du camp
Goli Otok demeure pour la société ex-yougoslave un sujet douloureux, objet de tabous, de polémiques, mais aussi d’efforts de mémoire initiés par d’anciens détenus ou leurs familles. Alain Jejčič souligne la difficulté de persister à faire reconnaître la singularité de la répression titiste, longtemps occultée par la doxa qui fait de la Yougoslavie un modèle de socialisme « libéral » face aux démocraties populaires du bloc soviétique.
L’île, aujourd’hui abandonnée, fait l’objet de visites de la part de chercheurs, de touristes et de quelques initiatives muséales, mais son histoire reste marginale dans l’historiographie yougoslave, comme dans la mémoire collective des anciennes républiques fédérées. Les témoignages recueillis tardivement montrent pourtant l’intensité de la souffrance, mais aussi la résilience des survivants.

L’Occident face à Goli Otok : un silence coupable ?
La question du regard portée par l’Occident sur Goli Otok, posée en conclusion par Jejčič, est fondamentale pour comprendre la manière dont s’élaborent les politiques de la mémoire et de l’oubli. La rupture entre Tito et Staline donne à la Yougoslavie une position unique sur la scène internationale, lui assurant dès la fin des années 1940 le soutien, stratégique et financier d’une grande partie des États-Unis et de leurs alliés.
Dans ce contexte de Guerre froide, la répression à Goli Otok fut largement ignorée par les chancelleries occidentales, qui fermaient les yeux — voire relativisaient la brutalité du système titiste au nom de la « stabilité » régionale et de la nécessité d’arracher Belgrade à la sphère d’influence soviétique. Peu d’observateurs ou de journalistes furent en mesure de dénoncer le sort des prisonniers. La légende dorée du « socialisme autogestionnaire » s’adapte à l’écran à la réalité carcérale du pouvoir titiste.
En somme, l’exemple de Goli Otok interroge la capacité de l’Occident à exercer un regard critique sur ses alliés circonstanciels, et met en lumière la prégnance de la raison d’État sur la défense des droits humains. Dans la mémoire européenne, Goli Otok rappelle que le socle de stabilité politique et d’influence stratégique peut conduire à occulter, voire à justifier, les pires abus.


