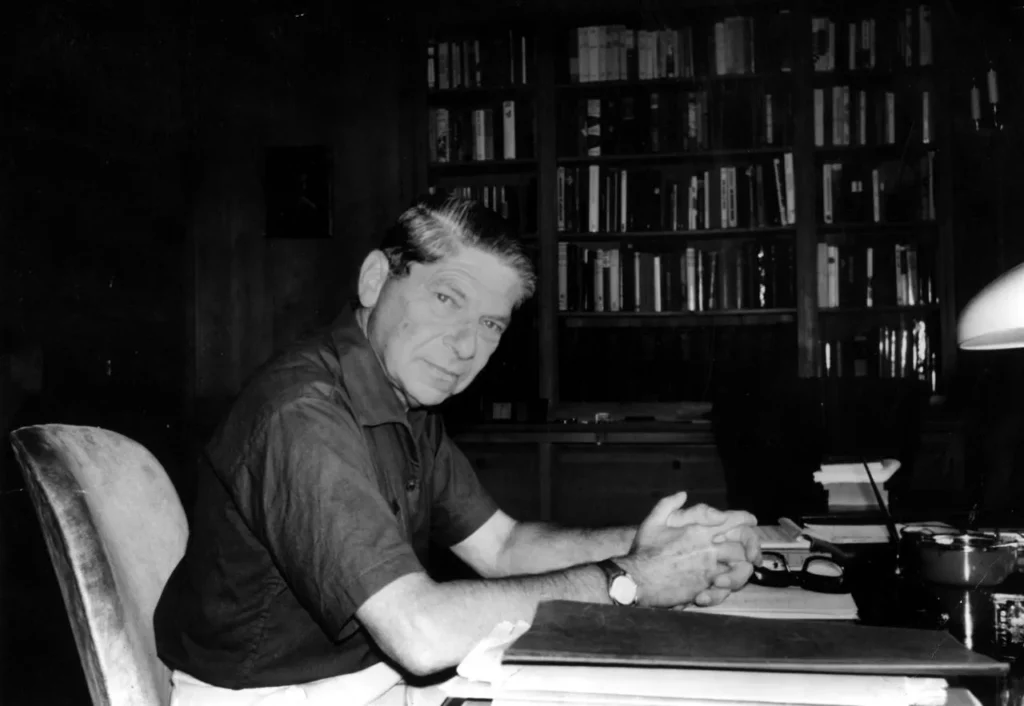
Dans le vaste champ de la philosophie politique, peu de formules ont suscité autant de débats que celle attribuée à Machiavel : « la fin justifie les moyens » . Elle condense l’interrogation la plus aiguë du politique : faut-il parfois sacrifier la morale au nom d’un bien supposé supérieur — liberté, justice ou salut de l’humanité ? C’est à cette énigme tragique que consacre Arthur Koestler dans sa trilogie, écrite entre 1939 et 1943.
À travers trois récits symboliques — la révolte conduite par Spartacus ( The Gladiators ), les procès staliniens ( Le Zéro et l’infini ) et la désillusion d’un révolutionnaire en exil ( Croisade sans croix ) — Koestler interroge la dialectique des fins et des moyens, de l’utopie et de la violence, de la conviction et de la responsabilité.
Spartacus : entre idéal fraternel et refus du « manteau du tyran »
Dans Spartacus , Koestler revisite la grande révolte servile contre Rome. Le thrace rêve d’édifier une « cité du soleil », une communauté égalitaire où n’existeraient plus ni maîtres ni esclaves. Mais la guerre oblige à des choix cruels : comment maintenir l’unité et la discipline d’une armée hétéroclite composée d’anciens gladiateurs, de paysans fugitifs, de scissionnistes guidés par Crixus ?
Le moment décisif qui souligne Koestler est le refus de Spartacus de massacrer les dissidents menés par Crixus. Cette clémence, ce scrupule « moral », compromettent d’emblée les chances de victoire. Rome triomphera parce que Spartacus, au fond, n’a pas accepté de revêtir le manteau du tyran absolu, seul capable d’imposer une unité de fer. Or c’est précisément ce choix qui révèle l’antinomie centrale : gouverner une révolte au nom de l’humanité sans se condamner à employer les méthodes inhumaines des oppresseurs.
Spartacus échoue donc parce qu’il demeure fidèle, par éclairs, à l’esprit d’égalité et de justice de son idéal. L’enseignement tragique est que seule la logique de la tyrannie aurait pu vaincre Rome, mais au prix de l’essence même de la révolte. Cela rappelle le dilemme analysé par Benjamin Constant : la liberté collective obtenue par l’asservissement de chacun n’est qu’une contradiction dans les termes. La fin — la liberté pour les esclaves — ne peut être atteinte qu’en employant des moyens qui la détruisent.

Le Zéro et l’infini : le sacrifice de l’individu à l’ombre de l’Infini
Avec Le Zéro et l’infini (1940), Koestler déplace le dilemme dans le XXe siècle. Roubachof, vieux bolchevik, est pris dans l’engrenage des procès staliniens. Il se laisse convaincre que son sacrifice, en confessant de faux crimes, servira l’unité du Parti et l’avenir du communisme mondial. Il devient le « zéro » résorbé dans l’« infini » de l’Histoire.
Koestler illustre ici la logique totalitaire qu’Arendt décrira : l’Histoire divinisée rend légitime la destruction des individus. Pour le Parti, toute vie humaine n’est qu’un pion sacrifiable dans une partie cosmique. Popper, dans
La société ouverte et ses ennemis , dénonçait déjà ce prophétisme historique : croire que l’Histoire obéit à une rationalité infaillible conduit à justifier aujourd’hui toutes les tyrannies.
Dostoïevski avait dit : « Si Dieu n’existe pas, tout est permis » . Pour Koestler, dans l’univers stalinien, tout est permis non pas en l’absence de Dieu, mais parce que l’Histoire a pris sa place. Les moyens — torture, mensonge, confession extorquée — ne sont plus instruments provisoires d’une révolution : ils deviennent la substance d’un régime total.

Croisade sans croix : l’éthique vacillante du révolutionnaire désenchanté
Dans Croisade sans croix (1943), l’ancien militant révolutionnaire, réfugié en Occident, revisite son engagement. Son combat fut une croisade « sans croix » : une guerre menée pour un but transcendant, mais privé de transcendance spirituelle, vite réduite à une mécanique idéologique.
Ce roman pose la question dans les termes de Max Weber : éthique de la conviction ou éthique de la responsabilité ? La première, fidèle aux principes absolus, risque le fanatisme ; la seconde, consciente des conséquences réelles, appelle à une prudence plus modeste. Mais comment rester fidèle à un idéal sans tomber dans le cynisme ? Le héros de Koestler, déchiré entre ces pôles, illustre l’incapacité du militant révolutionnaire à ajuster ses moyens à une justice humaine concrète plutôt qu’à un absolu abstrait.
Koestler, par cette œuvre, témoigne de sa propre expérience d’ancien communiste désillusionné : l’histoire des révolutions montre que l’idéal justifie rarement les sacrifices exigés en son nom. Les moyens façonnent la fin plus sûrement que la fin ne redresse les moyens.

De Machiavel à Camus : différentes déclinaisons du dilemme
Machiavel reste accusé d’avoir autorisé la maxime : « la fin justifie les moyens » . Or, chez lui, le calcul du prince n’est pas utopie mais nécessité pragmatique pour sauvegarder l’État. L’usage de la ruse et de la force est conditionné par la survie politique.
Au XXe siècle, Camus renverse la logique dans L’Homme révolté . Le révolté, dit-il, ne peut même franchir certaines limites sans trahir l’homme lui-même. La révolte n’est légitime que si elle reste solidaire de la dignité humaine ; sinon elle engendre un nihilisme meurtrier. Raymond Aron, plus analytique, lui recommandait aussi une politique de la mesure : conserver la conscience que tout absolutisme engendre mécaniquement la négation de ses promesses.
Koestler illustre donc, par la fiction, la thèse camusienne : là où les révolutionnaires acceptent de tout justifier pour l’avenir, ils s’excluent de l’humanité qu’ils voulaient sauver.
Enseignements de la trilogie
L’ensemble de la trilogie fait apparaître trois leçons philosophico-politiques :
- Le refus absolu du manteau du tyran condamne la révolte à l’échec ( Spartacus ), mais le porter signifierait déjà la trahir.
- L’histoire montre que les moyens s’imposent sur les fins : ils deviennent autonomes et façonnent la société à venir (
Le Zéro et l’infini ). - La désillusion enseigne la mesure : il faut reconnaître la fragilité du politique, ajuster la conviction à la responsabilité, et renoncer au rêve d’une fin rédemptrice (Croisade sans croix ).
Ainsi, Koestler peint un tragique de l’action historique : la victoire exige des moyens inhumains, mais leur usage détruit d’emblée la légitimité de la fin proclamée.
la fin, les moyens et le tragique politique
La formule « la fin justifie les moyens » trouve dans l’œuvre de Koestler une mise en échec éclatante. Spartacus illustre que la clémence ruine la chance de victoire, mais que seul le sacrifice de l’idéal eût permis la survie militaire. Roubachof montre que le calcul froid des moyens détruit la fin elle-même. Et le révolutionnaire désabusé révèle la vanité d’un combat sans ancrage éthique.

La réponse de Koestler, en fin de compte, converge avec Weber et Camus : la politique est tragique, car il n’existe pas d’action purement morale ni de fin purement rédemptrice. Mais les moyens employés déterminant toujours la qualité de la fin : employeur des méthodes tyranniques, c’est déjà préparer un monde tyrannique.
Autrement dit, ce n’est pas la fin qui justifie les moyens : ce sont les moyens qui impliquent la valeur de la fin . Et c’est là la leçon durable de Koestler, plus pressante que jamais à l’heure où l’Histoire continue de mettre l’humanité devant ses contradictions.


