
Au cœur de la confrontation idéologique entre Washington et La Havane durant la guerre froide, Cuba se trouva non seulement sous embargo économique mais également au centre d’accusations récurrentes d’attaques biologiques américaines. Ces opérations, niées par les autorités de Washington mais documentées par de nombreux chercheurs et instances internationales, s’inscrivent dans une stratégie plus large de déstabilisation du régime de Fidel Castro. Dès les années 1960, le programme américain de guerre biologique, initialement coordonné par le Fort Detrick Biological Warfare Center dans le Maryland, fit l’objet d’une série d’expérimentations secrètes sur le territoire américain et dans plusieurs pays cibles, notamment dans la Caraïbe.
Le contexte : la guerre froide et l’obsession cubaine
Après la victoire de la révolution cubaine en 1959 et l’alliance de Castro avec l’URSS, les États-Unis multiplièrent les tentatives d’affaiblir le régime, de la Baie des Cochons (1961) aux dizaines de complots d’assassinat contre ses dirigeants. Parmi ces méthodes figuraient la guerre biologique, envisagée comme une arme de déstabilisation économique et psychologique : atteindre la production agricole, le cheptel ou la population civile sans confrontation directe.
Le sud de la Floride, proche de Cuba, est devenu dès 1960 une base logistique pour des opérations clandestines de la CIA et de ses sous-traitants. Certains documents déclassifiés, rapportés notamment par le Church Committee (Sénat américain, 1975), attestent d’une coopération entre la CIA et l’Army Biological Warfare Laboratories pour expérimenter des vecteurs d’agents pathogènes, tels que moustiques Aedes aegypti infectés et spores de champignons destructeurs de cultures tropicales.

Les offensives suspectées : de la fièvre porcine à la dengue
L’épisode le plus documenté eut lieu en 1971 : la fièvre porcine africaine, jusque-là absente des Amériques, apparut fréquemment dans plusieurs élevages de cochons cubains. L’épidémie entraîne l’abattage d’un demi-million d’animaux et provoque une grave crise alimentaire. Quelques années plus tard, en 1981, Cuba subit une flambée de dengue hémorragique de type 2 — première de ce genre dans l’hémisphère occidental — faisant 158 morts dont 101 enfants, et touchant plus de 300 000 personnes. Le gouvernement cubain accusa directement les États-Unis d’avoir introduit le virus par un grand nombre d’insectes infectés à partir d’avions non identifiés survolant l’île.
Bien que Washington nia toute responsabilité, plusieurs indices convergents donnèrent du crédit à ces accusations. Des témoins exilés rapportèrent que la CIA aurait transporté des moustiques infectés depuis des laboratoires au Panama et les auraient disséminés au-dessus de zones rurales. L’hypothèse fut renforcée par la publication en 1984 des révélations de l’ex-agent de la CIA, Eduardo Arocena, chef du groupe anticastriste Omega 7, qui affirma devant un tribunal fédéral que son organisation avait introduit des germes de dengue à Cuba « comme mission biologique ». Ces déclarations n’ont jamais été suivies d’une enquête américaine approfondie.

Autres formes de guerre biologique et environnementale
Au-delà de ces épisodes emblématiques, d’autres cas suspects furent signalés : introduction de la rouille du tabac (1979), propagation de la moelleuse de la canne à sucre et du mildiou de la pomme de terre. En accumulant ces infections agricoles, Cuba a vu plusieurs de ses secteurs d’exportation — sucre, tabac, agrumes — brutalement effondrés durant les années 1970-1980. Pour un pays dont la survie économique reposait sur ces monocultures, ces attaques biologiques prévoyaient la dimension d’un bloc invisible mais dévastateur.

L’embargo économique et technologique concomitant empêcha l’importation de pesticides et de vaccins nécessaires à la lutte contre ces épidémies agricoles. L’ensemble forme un système de pression intégré : isolement diplomatique, famine organisée, sabotage économique et menace sanitaire.
Répercussions diplomatiques et juridiques
Les accusations cubaines furent portées à plusieurs reprises devant l’ONU et l’Organisation mondiale de la santé. En 1981, La Havane soumit un dossier complet à la Conférence du désarmement de Genève, y joignant des témoignages, photographies d’appareils de pulvérisation et rapports de vols d’aéronefs non identifiés. Aucun État occidental ne soustint officiellement la plainte. Les États-Unis rejetèrent « toute allégation de guerre biologique », invoquant un discours de désinformation orchestré par Moscou et ses alliés.
Pourtant, l’affaire s’inscrivait dans un contexte de méfiance croissante vis-à-vis des programmes biologiques américains : en 1969, le président Nixon avait officiellement annoncé la fin du programme offensif de guerre biologique, mais les activités de recherche double à Fort Detrick et dans des installations militaires (Dugway Proving Ground, Pine Bluff Arsenal) se poursuivaient encore plusieurs années sous couvert de défense biologique.

Héritage et postérité de la guerre biologique cubaine
Jusqu’à la fin des années 1990, Cuba demeura un foyer d’expérimentation suspecté par les États-Unis eux-mêmes : paradoxalement, ces derniers accusèrent ensuite La Havane de développer des armes biologiques, notamment sous l’administration Bush fils (2002), sans en apporter de preuve. Cette inversion de la narration illustre le glissement stratégique : la biopolitique, d’abord offensive, est devenue une rhétorique d’accusation réciproque au service des rivalités géopolitiques.
Aujourd’hui, l’historiographie de la guerre biologique contre Cuba reste divisée. Des travaux de chercheurs comme William H. Leitenberg, Stephen Endicott et Edward Hagerman soulignent la continuité entre le dispositif clandestin américain et certaines opérations conjointes avec des diasporas anticastristes. Les archives cubaines et soviétiques, quant à elles, plaident avec Constance pour la thèse d’une guerre silencieuse, destinée à asphyxier le socialisme caribéen.
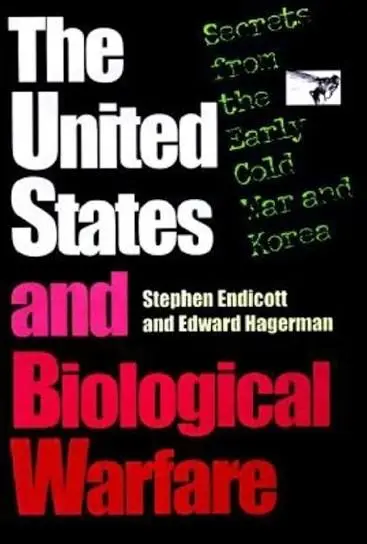
Qu’il s’agisse de preuves formelles ou d’un faisceau d’indices convergents, le dossier de la guerre biologique contre Cuba éclaire une page méconnue de la guerre froide. Derrière les slogans de la sécurité nationale, il révèle la tentation d’une biopolitique impériale : contrôler, affaiblir, voire éradiquer par les armes bactériologiques ce que la diplomatie et les armes classiques n’avaient pu renverser. La nature, instrumentalisée, est devenue son tour champ de bataille. Pour Cuba, ces attaques biologiques participaient à une guerre totale, dont les cicatrices agricoles, sanitaires et psychologiques restent encore visibles aujourd’hui.


