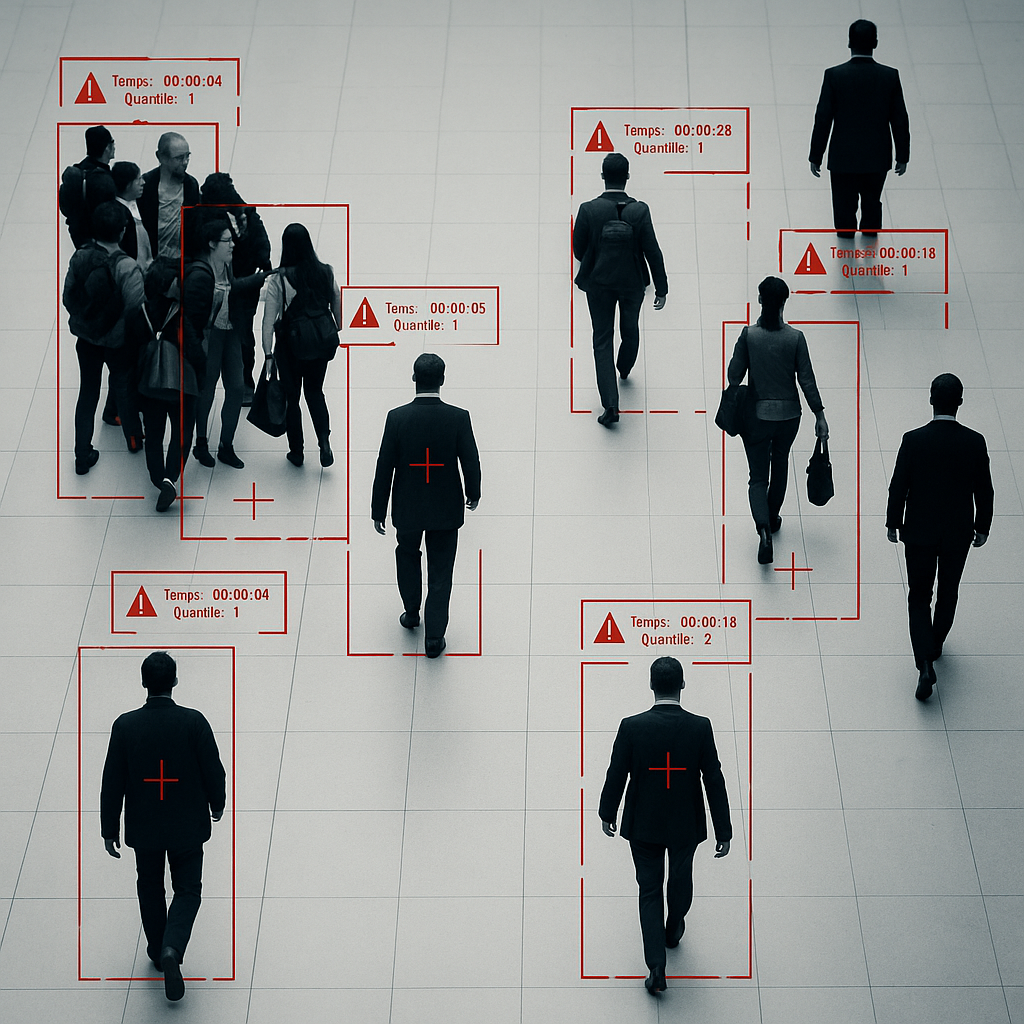L’évergétisme antique, pratique de bienfaisance ostentatoire par les élites, trouve une résonance troublante dans la philanthropie spectaculaire de certains milliardaires contemporains, notamment aux États-Unis. Cet article propose d’analyser les parallèles entre ces deux logiques d’action, en s’appuyant sur des exemples emblématiques de ploutocrates antiques et contemporains, et de conclure sur la rémanence des catégories sociales antiques dans le monde actuel.
Évergétisme antique : donner pour asseoir son rang
L’évergétisme naît dans les cités grecques et se développe durant la période hellénistique et romaine. Les notables (souvent des membres de l’aristocratie ou de riches marchands) financent la construction de temples, de théâtres, organisent des jeux ou des distributions de nourriture, dotent la cité d’infrastructures publiques ou offrent des libéralités lors d’épidémies ou de catastrophes. Chez les Romains, le don public n’est jamais désintéressé : il permet d’acquérir du prestige, de la reconnaissance et souvent du pouvoir politique. Les actes de bienveillance sont gravés dans la pierre, célébrés par des statues, inscrits dans le droit d’accès aux places d’honneur lors des fêtes civiles ou religieuses, et leur mémoire ne s’efface pas, mais se transmet. Des figures telles que M. Nonius Balbus à Herculanum, reconstructeur du rempart et de la basilique après le séisme de 62, ou les frères Lucii, affranchis novateurs, sont des exemplaires.

Les « nouveaux évergètes » : philanthrope milliardaire et société du spectacle
La philanthropie contemporaine des milliardaires américains s’inscrit dans une logique de visibilité et de légitimation, mobilisant des sommes colossales et s’accompagnant d’une médiatisation soigneusement orchestrée. Les fondations de Warren Buffett, Bill Gates, George Soros ou Mark Zuckerberg ressemblent, par leur ampleur et leur impact, aux actes des évergètes antiques. Le don n’est ni modeste ni anonyme : il prend la forme d’initiatives structurantes, comme la construction d’universités, de centres de recherche, la réforme de l’éducation ou de la justice pénale. L’initiative Chan Zuckerberg, par exemple, investit des milliards dans des causes éducatives et scientifiques, montre sa volonté de « faire progresser le potentiel humain ». Buffett et Gates rivalisent en montant des fondations qui concentrent le pouvoir de sélection des destinataires et la capacité à définir les priorités sociales. MacKenzie Scott, ex-épouse de Bezos, incarne une philanthropie massive, polyvalente, quasi « missionnaire ».

Ploutocrates antiques et milliardaires philanthropes
Dans les deux cas, le don est un vecteur de reconnaissance. Loin du désintéressement, il est autant investissement social qu’acte de gouvernance. Offrir, c’est régner — hier sur la cité, aujourd’hui sur l’opinion publique et les politiques sociales. Les deux types d’élites combinent souci de l’intérêt général et défense de leur rang, usant de largesses pour asseoir leur pouvoir et inscrire leur nom dans l’histoire. La philanthropie américaine, qui s’affirme via des fondations
« brandées » , s’appuie sur la visibilité, sur la durée et sur la capacité à mobiliser d’autres acteurs sociaux.

Résurgence des classes sociales antiques : patriciens, plébéiens, métèques et esclaves
La permanence des logiques sociales antiques dans la société contemporaine interroge :
- Les patriciens : dans le système actuel, les grandes fortunes et leur capacité à agir sur le destin commun, que ce soit via la philanthropie ou le lobbying, reproduisent la position dominante des patriciens antiques, arbitres des ressources et de la reconnaissance.
- Les plébéiens : représentent aujourd’hui la masse citoyenne, bénéficiaires ou spectateurs des largesses, souvent sans accès réel au pouvoir de décision et à l’élaboration des priorités. Comme chez les Romains, l’accès aux ressources reste filtré. ils disposent toutefois du droit de vote.
- Les métèques/esclaves : hier exclus du droit de cité et réduits à la position de force de travail, privés du droit de vote et dépourvue de tout pouvoir politique. Ils peuvent être rapprochés des travailleurs précaires, des migrants et, parfois, des classes subalternes, dont la parole et la reconnaissance sont encore limitées.
La structure sociale qui émerge autour de la philanthropie des milliardaires, où ceux-ci incarnent la puissance du don et la capacité de transformation de la société, rappelle la verticalité des rapports sociaux antiques. La générosité ostentatoire, loin de dissoudre les hiérarchies, tend à les réinscrire, transformant les donateurs en arbitres légitimes du bien public. L’illusion démocratique peut masquer la réalité : la société du spectacle philanthropique accorde la vedette à quelques ploutocrates sur fond d’une reproduction des clivages anciens.

À la lumière de l’évergétisme et de la philanthropie moderne se dessine donc une question cruciale : la résurgence des structures sociales de l’Antiquité invite-t-elle à reconsidérer la nature du pouvoir et la définition de la légitimité ? Si l’histoire ne se répète jamais à l’identique, elle dévoile la persistance d’un jeu subtil entre don, reconnaissance et domination – hier comme aujourd’hui.